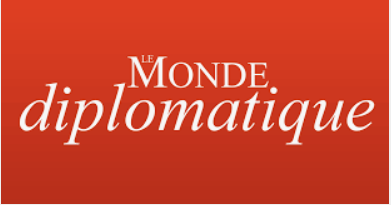[fusion_builder_container type= »flex » hundred_percent= »no » equal_height_columns= »no » hide_on_mobile= »small-visibility,medium-visibility,large-visibility » background_position= »center center » background_repeat= »no-repeat » fade= »no » background_parallax= »none » parallax_speed= »0.3″ video_aspect_ratio= »16:9″ video_loop= »yes » video_mute= »yes » border_style= »solid »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ type= »1_1″ background_position= »left top » border_style= »solid » border_position= »all » spacing= »yes » background_repeat= »no-repeat » margin_top= »0px » margin_bottom= »0px » animation_speed= »0.3″ animation_direction= »left » hide_on_mobile= »small-visibility,medium-visibility,large-visibility » center_content= »no » last= »no » hover_type= »none » border_sizes_top= » » border_sizes_bottom= » » border_sizes_left= » » border_sizes_right= » » min_height= » » link= » »][fusion_text]
Essais inédits , dialogue M. Deguy / Pierre Caye
Michel Deguy est un poète, traducteur et essayiste français né le 23 mai 1930 à Paris, rédacteur en chef de la revue Po&sie.
Pierre Caye est un philosophe et directeur de recherche au CNRS. Il a fondé le groupement de recherche international du CNRS «Savoirs artistiques et traités d’art de la Renaissance aux Lumières».
Michel DEGUY • Pierre CAYE
MICHEL DEGUY: Pierre Caye est un savant hors pair, doctissime
Théoricien, est-il irréfutable ? Mais s’agit-il d’une théorie, dont la « falsifiabilité » garantirait la scientificité ?
Que pourrait être le « se tromper » dans son cas ?
L’affaire est celle du patrimoine, et de l’espoir que Caye entretient quant au sens traditionnel de la patrimonialité. Une autre clairvoyance est-elle « opposable » ?
La mévue n’est pas une bévue.
Voici les généralités de mon approche différente qui porte sur la faiblesse de la notion d’« environnement » ;Le trop tard de l’écologie impuissante ; L’ignorance du phénomène culturel social total, qui a dépatrimonialisé le patrimoine en le « culturel-isant » ;L’hégémonie trompeuse de la permanence de termes, non seulement vidés de leur sens, mais remplacés par leur contraire à mauvais escient ;La faiblesse insigne de la distinction spiritualiste entre matériel et immatériel (que la notion lyotardienne de « l’immatérial » n’a pas amendée), si la matérialité est celle du signifiant ;L’obsolescence de l’homme (Günther Anders), et sa fin prochaine.
Il est stupéfiant que dans un ouvrage aussi considérable que Durer, qui fait suite à un exercice de lucidité aussi éclairant que celui qui concerne « la destruction créatrice », c’est-à-dire la pensée-unique économiste de la croissance par la consommation, aucun développement autonome ne cible la publicité, qui est le foyer central de l’annihilation.
La publicité n’est pas « un aspect des choses ». Le moteur de la croissance de la croissance est la relance par la novation. Un rasoir à cinq lames, « qui change la vie », relègue à la déchetterie le rasoir à quatre lames – en attendant le six lames. La 5G c’est beaucoup mieux que la 4G, en attendant la 6.
Mais l’obsolescence, pour l’oreille philosophique, c’est en fin de compte l’obsolescence de l’homme, comme l’avait vu Günther Anders.
Reprenons.
Hitler conquit son peuple et l’Europe par la propagande.
Or la publicité est 10ⁿ fois plus puissante que la vieille propagande. Il faut regarder cette méduse en face, sous peine de cécité.
- a) La vie des humains au 21 siècle est entièrement «servitude»
- b) La publicité occupe tous-les-écrans (comme eût dit Lagarce)
- c) Ce phénomène social total est dénié par la publicité.
-
d) L’énoncé publicitaire (L’Oréal lave plus blanc), le slogan, ni vrai
-
e) La signification kantienne, ou des « Lumières », de l’espace
- f) La « servitude volontaire », mutée en obéissance massivement.
Ne pas reconnaître ces faits, c’est se laisser méduser.
PIERRE CAYE: Vous vous étonnez du peu de place qu’accorde à la publicité ma critique du système productif et de l’économie de marché, d’omission d’autant plus étrange et déplorable qu’on ne saurait minimiser, et je suis tout à fait d’accord avec vous sur ce point, le rôle considérable que joue la publicité dans la constitution symbolique de notre réalité contemporaine. On pourrait citer à cet égard la formule provocante de Patrick Le Lay, l’ancien P.-D.G de TF1, affirmant que «ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible».
Le P.-D.G de TF1 ne se contente pas de signifier l’importance dans l’industrie des programmes télévisuels de la publicité et de sa puissance financière.
Il dit quelque chose de moins banal, à savoir que la publicité et son efficace dépendent d’un dispositif narratif plus vaste, où elle-même s’inscrit, qui comprend non seulement l’industrie des programmes, mais l’ensemble des activités d’information et de communication ainsi que les nouvelles technologies qui en soutiennent la diffusion, sans oublier la communication politique ou l’ingénierie culturelle. La publicité n’est pas simplement une industrie tertiaire parmi d’autres au service du développement « hyperindustriel » de nos sociétés productives, mais elle constitue un régime général de la narration, omniprésent, dominant et codé, qui conduit sans aucun doute à l’appauvrissement de la langue, de l’imaginaire et de leur ordre symbolique.
Cela ne m’échappe pas.
Pourtant je n’en fais pas le noeud de ma critique. Et assurément je dois m’en expliquer.
À la lecture de l’Action humaine, le grand traité d’économie de Ludwig van Mises de 1949, qui pose les principes de la marchandisation générale de la société, ce que Mises appelle la « praxéologie », je suis frappé par le mépris que ce texte porte à la publicité, qu’il réduit à de la propagande.
Pour Mises, la publicité ne fait que fausser l’allocation optimale des facteurs de production à laquelle conduit la liberté des interactions favorisées par l’échange monétaire.
La publicité n’est rien d’autre, selon lui, qu’un mode d’intervention politique au service des grands trusts – d’où son assimilation à la propagande – dans le libre champ de l’économie.
Pourtant, on ne peut que constater que, sans la publicité, le marché n’aurait pu autant se propager et imposer ses règles, et qu’elle constitue l’un des instruments principaux de la marchandisation générale de la société.
Mais en est-elle pour autant l’essence ? Ou bien n’en est-elle qu’un instrument ou une prothèse ? Il apparaît en tout cas assez clairement que le système économique actuel est un dispositif practicodiscursif complexe qui ne saurait entièrement correspondre aux principes de la doctrine néolibérale mais qui, pour mieux fonctionner, intègre des éléments qui parfois rentrent en contradiction avec celle-ci.
Dans ces conditions, est-il encore nécessaire de parler de thèse et de prothèse, d’essence et de supplément, de centre et de périphérie ? La prothèse ne finit-elle pas par se substituer à ce qu’elle est censée suppléer ?
Mais, pour que cela se vérifie, il faudrait pouvoir renverser la proposition, c’est à dire affirmer non plus que la publicité est l’instrument et la prothèse du marché comme je viens de le faire, mais, inversement, que le marché et l’échange ne sont que la prothèse ou plus exactement le prétexte du devenir publicitaire de la narration qui caractérise les sociétés contemporaines.
Et cela je ne crois qu’on puisse à ce point l’affirmer, du moins en l’état actuel du marché et de son fonctionnement. La publicité rend visible le marché, et tout dispositif practico-discursif a certes besoin de visibilité pour dominer.
Mais, et c’est là sans doute où je m’écarte de vous d’un point de vue proprement philosophique –, le marché domine la société non pas par sa visibilité, mais, au contraire, par l’invisibilité de ses mécanismes, comme en témoigne l’industrie financière, par sa domination aveugle, par son mutisme, dont fait preuve par exemple l’instrument monétaire, une invisibilité et un mutisme que gèrent non pas la publicité, mais les nouvelles technologies fondées sur les big data et les algorithmes dont le règne relève de tout autres principes que celui de la narration, serait-elle publicitaire.
Il faut mesurer aujourd’hui la puissance sur les choses des chiffres qui se substituent aux mots et aux images, et qui destituent ainsi le règne symbolique de la narration publicitaire sur le réel, un règne en lui-même déjà fragilisé par l’appauvrissement de la langue sur lequel il repose.
MICHEL DEGUY: Ici je renforce notre différend. Charles Péguy, l’admirable dreyfusard, l’inoubliable recréateur du monde oublié des Hussards noirs de la République, des instituteurs et du monde du travail, écrit dans L’Argent (1913, Cahier XIV, tome III des OEuvres en prose, édition Pléiade page 800) :
Description de l’ancienneté patrimoniale. C’était l’âge du patrimoine.
Auquel ont succédé des âges de dévastation jusqu’à celui-ci, le nôtre, âge de la défiance, de la vengeance, de la haine en réseaux sociétaux, et de l’ingérabilité des sociétés – que seul le contrôle « chinois », total, implacable, « solutionnera » comme dit la novlangue (pour qui les verbes du troisième groupe sont trop difficiles).
PIERRE CAYE: En agitant le spectre de l’inflation et de ses conséquences sociales, Péguy exprimait d’abord son hostilité aux flux de l’économie que vous symbolisez justement sous la forme des réseaux sociaux et de l’ingérabilité des sociétés.
Et à ce titre vous avez raison de définir sa conception de la société comme patrimoniale s’il est vrai que le patrimoine ne renvoie à rien d’autre qu’à cette part de la richesse que l’on essaie d’une façon ou d’une autre d’extraire des flux du commerce et de l’échange pour former une réserve, un trésor qu’il convient de protéger et de transmettre, conception de la richesse qui s’oppose ainsi frontalement à la gestion anomique du capital que favorise notre époque, par prédation et accumulation sauvages. Il n’est pas d’autre façon d’assumer pour la génération présente sa responsabilité à l’égard des générations futures que de patrimonialiser ce qu’il est nécessaire de transmettre.
Et à ce titre j’adhère pleinement à ce texte de Péguy. J’ajouterai, pour en rester à la dimension économique qu’évoque ce texte, que la patrimonialisation permet de favoriser le développement social sans nécessairement recourir à la croissance.
Je ne crois pas néanmoins que la patrimonialisation des biens soit nécessairement liée à la hiérarchie et à l’inégalité des anciennes sociétés qui l’ont instaurée, et qui l’ont instaurée précisément pour assurer leur développement en l’absence de croissance économique.
Les régimes juridiques qui mettent en valeur la notion de patrimoine aujourd’hui, le domaine public ou le Patrimoine commun de l’humanité, visent au contraire un meilleur partage sinon des biens, du moins de leur usage.
La patrimonialisation est une façon d’étendre l’usage universel et public du capital.
MICHEL DEGUY: « Le couscous entre au patrimoine mondial immatériel universel de l’humanité » — le couscous apaisé, enfin égalé à la pizza, trésor des mois d’avant. Que signifie cet énoncé extravagant ?
Comment le couscous devient-il « immatériel », et du coup patrimonialisé « mondialement » ?
C’est-à-dire partout, i.e. « ni vu ni connu » : il n’a pas lieu d’être mangé.
La valeur, la valeur nietzschéenne, imposa la question universelle du19 siècle « mes valeurs, nos valeurs, tes valeurs »… En quoi a muté la« valeur » ?
Une proclamation de l’ONU arrache une chose à sa matérialité de bon repas goûteux maghrébin.
Je dis « couscous », et hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour en tant que quelque chose d’autre que les merguez connues, musicalement se lève, idée même et suave, l’absent de tout repas.
Opération mondiale médiatique instantanée, le couscous entre au menu de tous les écrans, concurrent publicitaire – pareil à une entrée en Bourse.
Le trésor mondial n’est pas « marchandise » ; mais proposé en fin dernière (« telos ») à l’humanité touristique.
Il faut parler du tourisme.
Le tourisme n’est pas un « secteur économique » parmi d’autres ni le symbole du « loisir » de privilégiés, etc… mais la partie qui montre le tout.
La réponse au « Que faire ? » de Lénine : l’avenir de l’humanité en croisières de curiosité culturelle, en retraites, autrement dit la récompense de vivre enfin (en fin de vie, occultée par la longévité), pour sa seconde moitié désoeuvrée (de 60 à 100 ans).
PIERRE CAYE: De mon côté, j’aborde la notion de patrimoine plus en juriste qu’en administrateur de la culture. Le patrimoine, avant deconcerner la conservation des biens culturels, définit d’abord un régime général des biens. Or, le patrimoine culturel qui apparaît pour l’opinion commune comme le patrimoine par excellence, se révèle sur ce point de plus en plus vulnérable. La politique culturelle actuelle consiste à marchandiser le patrimoine, à en faire une source de profit, c’est-à-dire, si on s’en tient du moins à la définition du patrimoine que je viens de donner plus haut, à « dépatrimonialiser » le patrimoine, à le réintégrer dans les flux commerciaux dont son régime juridique tend pourtant à l’extraire ; en témoigne le récent rapport Perrault-Bélaval qui vise à transformer l’environnement de Notre-Dame – l’Hôtel-Dieu ainsi que les sous-sols de la place de Lutèce et du parvis de la cathédrale – en zone commerciale. Je ne crois pas que ce projet soit à la hauteur des sentiments qu’a partout suscités l’incendie de Notre-Dame. Il est évident que cette marchandisation du patrimoine artistique est étroitement liée au développement du tourisme et de ses nouvelles pratiques que vous dénoncez.
Ne reste plus du patrimoine au ministère de la Culture que le nom de sa direction. Reste à définir ce que doit être une véritable politique culturelle du patrimoine au service du public, digne des enjeux politiques, juridiques et sociaux qu’implique cette notion prise en son essence.
Sans doute faudrait-il déjà s’engager dans un processus de «démarketing» du patrimoine comme certains acteurs publics au demeurant commencent à le préconiser.
MICHEL DEGUY: Venons-en au Gestell. Je ne crois pas du tout que
« l’industrialisation scientifique du monde », selon une des formulations
à cause d’une vue rendue myope par la « mobilisation totale » (Jünger) au service du Plan. L’hypercomplexité Big Data. I.A., la screenisation générale de l’existence (notre « vie » est une application), l’identification par ADN et algorithmes ne font que déployer le Gestell, le prouver, si on peut dire.
PIERRE CAYE: Je ne dis pas que le Gestell ou dispositif de la technique ne puisse décrire notre siècle.
Davantage, je reconnais pleinement avec Heidegger la nature métaphysique du dispositif, le fait qu’il représente unétat du système, c’est-à-dire de l’articulation de l’être humain, du monde et du principe qui, sous forme du dispositif technique, se présente pétrifié, bloqué, réduit à l’immanence radicale d’une exposition universelle d’étants. Mais je suis moins en accord avec l’idée heideggérienne que le règne de la technique constitue la fin ou l’accomplissement de la métaphysique, et que l’histoire de cette métaphysique se résume à ce long processus de subjectivation et de rationalisation du réel au service de sa disponibilité infinie. À la suite de la crise de 1929, la technique vient à dominer l’économie ; Heidegger ne parle jamais d’économie ; la technique à ses yeux vaut pour toute domination. On ne saurait pourtant faire le procès la domination actuelle sans questionner l’économie ; de fait, à partir des années 1980, la révolution néo-libérale renverse ce rapport : c’est l’économie qui détermine la technique comme en témoigne la théorie économique,aujourd’hui dominante, dite «de la croissance endogène».
La nature du dispositif s’en trouve radicalement changée ; le triomphe du marché s’accompagne d’un processus de désubjectivation qu’Agamben décrit dans son petit essai sur Qu’est-ce qu’un dispositif ?
Le marché ne repose plus, comme le Gestell technique, sur une accumulation de subjectivité, mais, ainsi que le note Sloterdijk dans La mobilisation infinie, sur une accumulation, je dirai plutôt une intensification, de l’énergie cinétique.
Ce n’est plus le blocage du système, sa rationalisation, qui sont en cause, mais sa fluidification, sa désinstitutionnalisation généralisées, voire son chaos organisé.
Nous passons de la mobilisation totale à la mobilisation infinie.
Or, les notions de mise en mouvement et de mobilité ne sont pas les mêmes d’une mobilisation à l’autre. La question de la métaphysique et de sa critique change alors de nature : il ne suffit plus de dénoncer le primat de l’acte sur la puissance qui caractériserait l’ontologie traditionnelle, mais de remettre en cause le couple de l’acte et de la puissance en son ensemble, comme origine de la mobilisation du monde et de l’intensification de son énergie cinétique. Ce qui implique une critique non plus interne mais externe de l’ontologie qui renvoie à son tour à une tout autre généalogie de la métaphysique, celle non plus de l’oubli de l’être, mais de l’oubli de son autre : l’un.
Ce qui m’a conduit à relire les néoplatoniciens, Plotin, Proclus, Damascius, les penseurs de l’un, de façon assez différente par rapport à ceux qui se contentent d’en faire la matrice de l’onto-théologie.
MICHEL DEGUY: «Die Frage nach dem Dinge». De quoi est-il question avec Heidegger ?
Il s’agit du rapport de l’Être au Dire, (« einaï/legeïn »).
L’être «veut dire».
Que veut dire «ça veut dire» ?
Or se joue en ce siècle le destin de « l’être-parlant ». Les êtres-parlant sont expulsés du langage de leur langue. Certes la domestication prête son ouïe anthropomorphiste à un «vouloir dire» du chat, du chien, du cheval. Mais le «vouloir dire» de la girafe au vermisseau, ou du platane au chêne, n’est pas audible.
Or j’ajoute que je ne crois pas que l’écologie salvatrice repose sur cette croyance.
L’être veut dire. Il invente la parole (« le logos »).
Il veut dire quelque chose en choses qui le font oublier. La différence entre «étant», chose, objet est pensable, dans l’attention à Heidegger.
PIERRE CAYE: Vous rappelez combien Heidegger est le philosophe par excellence de la différence, précisément parce qu’il est le seul à fonder la différence anthropologique entre l’homme et l’animal (le Da-sein) sur la différence métaphysique, et plus précisément, ontologique, entre l’Être et les étants. Davantage, vous rappelez que la Parole articule ces deux différences l’une à l’autre, et les fait vivre. L’expulsion hors de la langue des êtres-parlants est la conséquence de la réduction de la différence.
Et vous êtes tout à fait en droit de me demander : «Et votre différence, parle-t-elle ? Où est sa possibilité poétique ?» L’architecture est à mes yeux la poétique de l’Un, ce qui assure la médiation entre l’un et l’être dans le respect de leur irréductible différence ; la poétique architecturale est inscrite, pour le meilleur et pour le pire, au sein même du système productif, au risque de s’y dissoudre mais aussi, pour contrepartie, avec la possibilité même de le renverser de l’intérieur. Il est vrai qu’il y a quelque chose de mutique dans l’architecture. N’est-elle pas, comme l’écrit Nietzsche dans le Crépuscule des Idoles, l’art « qui n’a pas besoin de démonstration, qui dédaigne de plaire, qui répond difficilement, qui ne se sent pas de témoin autour d’elle, qui, sans en avoir conscience, vit des objections qu’on fait contre elle » ! En devient-elle pour autant étrangère à la Parole ?
MICHEL DEGUY: C’est le transcendantal qui demande à être repensé.
La relation kantienne de la subjectivité à l’objectivité reposant sur la distinction séparatrice du phénomène et du noumène aboutit à la dualité postmarxiste, disons communiste, du «subjectif erroné» et de «l’objectif» décrété par l’État totalitaire.
Il n’y a pas d’en soi. Le phénoménal, notre monde de la Terre, ouvre l’être «comme il est».
La différence hénologique ne «remplace» pas, venue des néoplatoniciens, la différence ontologique. L’être et l’un, c’est la question parménidienne : l’Un et le Multiple.
La multiplicité est la splendeur éclatée de l’un.
PIERRE CAYE: Oui, bien sûr, la transformation du système productif, la démobilisation du marché sont une affaire de transcendantal.
Le transcendantal se présente sous deux modalités : esthétique et métaphysique.
L’esthétique transcendantale rend raison de notre rapport au temps et à l’espace, qui lui-même conditionne nos conceptions et nos perceptions ; le transcendantal métaphysique relève de la différence, l’ontologique ou hénologique, peu importe ici. Heidegger a su mieux que tout autre entretisser ces deux modalités, et faire de ce tissage le travail le plus haut de la philosophie. Simplement, il me semble que, pour répondre à l’instantanéisme et à l’ubiquisme du marché et des nouvelles technologies de l’information et de communication qui en assurent la logistique, il importe de dilater l’espace et le temps, qui relève d’un espacement, d’une «diastématisation», d’une mise en intervalle, requérant une force de tenue et de maintien que seule est en mesure de garantir la différence hénologique, c’est-à-dire la différence entre l’un et l’être, entre le principe de cohérence du monde et son principe d’existence.
C’est pourquoi, j’hésiterai à chanter avec vous «la splendeur éclatée de l’un», qui conduit à la dispersion et à la dissémination du multiple jusqu’à l’impossibilité même de le penser comme nous en avertit Platon dans son Parménide. La différence ontologique est alors dissoute, à moins que la violence divine, au sens de Benjamin, vienne relever l’être, son éclatement et son éclat. Je préférerais parler pour ma part de la splendeur de l’un imparticipable, de son ermitage, de son retrait par rapport à toute substance, de toute unitotalité immanente, qui fait de la différence hénologique la gardienne même de la différence ontologique.
Voilà sans doute le point sensible de notre différend sur la différence: la différence l’ontologique a-t-elle besoin d’une garde ? Si oui, cette garde relève-t-elle encore du travail de la métaphysique (ma position) ou dépend-elle d’événements singuliers, voire, comme l’évoque in fine Heidegger, de la possibilité, sinon de l’advenue, d’un dieu.
Transcription du débat entre Pierre Caye et Michel Deguy ayant débuté le 24 mai 2019 par l’intervention de Michel Deguy dans le cadre du séminaire Art, technique, production dirigé par Pierre Caye et qui s’est poursuivi à la suite de la publication du nouveau livre.
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]